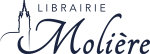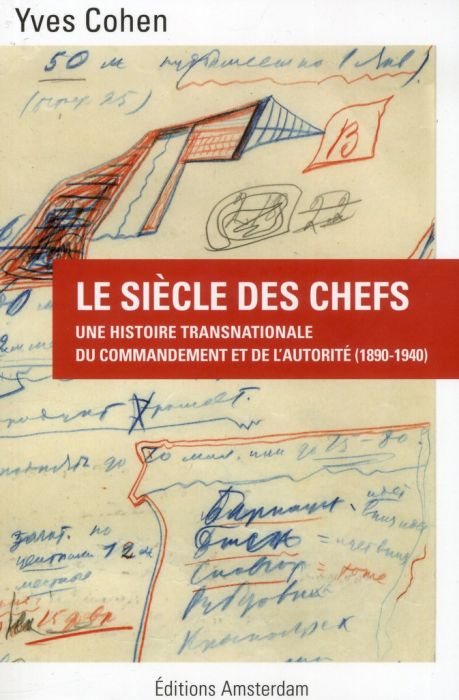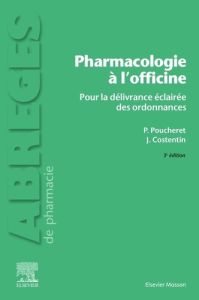Il s'agit d'un magasin de démonstration. Aucune commande ne sera honorée.
Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commendement et de l'autorité (1890-1940)
Extrait de l'introduction généraleLe XXe siècle a été beaucoup plus marqué par les cultures du commandement et du chef que les historiens ne l'ont montré jusqu'ici. A partir des années 1890, une préoccupation pour le chef se fait jour au moins dans les quatre pays qu'aborde cet ouvrage, la France, l'Allemagne, l'Union soviétique et les États-Unis. Un intérêt considérable pour le commandement (ou le leadership, la Führung, en russe le rukovodstvo) se manifeste sous forme de refontes hiérarchiques, d'inflexions de pratiques, de débats, de publications les plus diverses, de formations spécifiques, de développements dans les sciences humaines. Non seulement une crise de l'autorité est détectée, mais la solution en est invariablement le recours à des chefs: «On a besoin de chefs» se dit alors dans toutes les langues des pays les plus industrialisés.La hantise et l'obsession du chef, la formation et le culte de la figure du chef ne sont pas le propre des «totalitarismes» de la première moitié du XXe siècle, du fascisme, du nazisme ou du stalinisme. Ils croissent et prospèrent aussi en terrain capitaliste et libéral. Ils ne sont pas non plus l'exclusivité de quelques-uns des grands chefs que la période voit apparaître. Ils sont un des modes de la discussion des sociétés sur elles-mêmes. La forme la plus extrême que leur donnent le nazisme et les autres cultes du chef qui sont des évidences de la mémoire collective mondiale, comme ceux de Staline et de Mussolini, n'est somme toute que l'expression la plus radicale d'un phénomène ordinaire de la vie des sociétés de ce temps. Dans la diversité des configurations nationales, les élites dirigeantes s'inquiètent des phénomènes de masse nouveaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, qui risquent d'échapper au contrôle, tant dans l'industrie, dans la guerre que dans la politique - et les élites en question peuvent aussi bien être celles du mouvement social. La recherche de nouvelles formes et techniques de commandement et l'invention de la figure du chef, accompagnées par l'affirmation de l'éternelle nécessité des hiérarchies, compensent la disparition ou l'impuissance de la classe destinée au commandement, l'aristocratie. La relation hiérarchique est prise de façon intense comme objet de pensée, de littérature, d'écrits, de pratiques, d'institutions à partir de la toute fin du XIXe siècle à peu près en même temps dans un très grand nombre de pays dont nous ne tenterons pas d'établir la liste mais qui sont au moins ceux où la révolution industrielle connaît alors une forte affirmation. Avec des intensités variables, la concentration sur le chef ne lâche pas, durant des décennies, les sociétés où elle est apparue. Aujourd'hui, si une crise de l'autorité continue d'être infatigablement détectée comme au début du XXe siècle, le «chef» n'en est plus la solution universelle. Au contraire, les foules qui émergent en tant de points du monde se déclarent «sans leader».Pour les auteurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, l'humanité a toujours connu des chefs et même le règne animal est imprégné de rapports de subordination. Le repère majeur de cette pensée est l'ouvrage du sociologue Alfred Espinas, de 1877, Des sociétés animales: «C'est bien souvent que M. Espinas, dans ses observations sur les sociétés de nos frères inférieurs, a été frappé du rôle important qu'y joue l'initiative individuelle. Chaque troupeau de boeufs sauvages a ses leaders, ses têtes influentes», écrit Gabriel Tarde en 1890'. Il s'agit pour ces auteurs de faire le constat pragmatique d'un phénomène jugé universel qui veut qu'un regroupement quelconque en train de se faire suscite l'émergence d'au moins une personne qui prend en charge plus que les autres la résolution de tel problème posé à tel moment. La sociologie dans les limbes, avant même qu'elle ait une existence universitaire, le notait déjà au début du XIXe siècle sous la plume de Louis de Bonald: «Il n'arrive pas un accident dans les rues de nos cités populeuses, un accident qui rassemble la foule, sans qu'on y trouve une image de cette formation fortuite de la société, et qu'il s'y montre quelque homme plus intelligent, plus hardi et plus fort que les autres pour réparer le mal ou en prévenir les suites, et des hommes pour l'aider. On le remarque jusque dans les jeux des enfants, parmi lesquels il se trouve toujours un petit pouvoir pour commander et diriger. La nature se retrouve partout.» Ce qu'il convient ici de souligner est la manière dont le constat est formulé (vocabulaire) et élaboré (thèse sociologique): la «formation» de la «société» est un phénomène paradoxalement naturel et elle consiste en l'apparition d'un «pouvoir» pour commander et diriger. Non seulement le chef, mais la hiérarchie est bientôt naturalisée: «Le XIXe siècle a vu se fonder deux sciences admirables: la biologie et la sociologie. Or s'il est une vérité que ces sciences proclament et promulguent d'une façon éclatante, c'est bien la légitimité de la hiérarchie», écrit un auteur français influent en 1894. La hiérarchie et sa légitimité sont déclarées en même temps des faits de nature et des faits sociaux. Le naturel est intrinsèquement social et le social naturel: c'est ce qu'on nous dit en pointant la hiérarchie.
25,00 €
Disponible sur commande
EAN
9782354801205
Caractéristiques
| EAN | 9782354801205 |
|---|---|
| Titre | Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commendement et de l'autorité (1890-1940) |
| Auteur | Cohen Yves |
| Editeur | AMSTERDAM |
| Largeur | 140mm |
| Poids | 926gr |
| Date de parution | 23/01/2013 |
| Nombre de pages | 870 |
| Emprunter ce livre | Vente uniquement |